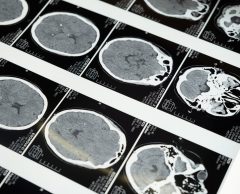Partager la publication "Douglas Kennedy : « Il nous faut réinventer le rêve américain »"
Cet entretien a été publié dans le numéro d’automne de WE DEMAIN, toujours disponible sur notre boutique en ligne.
En ce début de mois de juillet, Douglas Kennedy est inquiet. L’Europe vient de refuser d’accueillir les Américains suite à l’aggravation de l’épidémie de Covid-19 aux États-Unis. Lui qui se rend à Paris tous les quinze jours ! « Cela fait quatre mois que je suis confiné dans le Maine ; Paris me manque, la France me manque… J’espère que je vais pouvoir venir avec mon passeport irlandais…«
Douglas Kennedy est un véritable Euro-Américain. Né en 1955 à New York, il y a vécu jusqu’à 22 ans, puis a passé les années 1980 et 1990 en Europe – Dublin, Paris, Londres – avant de s’installer dans le Maine, près du Canada. C’est dire s’il connait bien les deux cultures, l’américaine et la française…
Il a décrit l’époque d’intolérance du maccarthysme dans La poursuite du bonheur (Belfond, 2001) et raconté l’insouciance libertaire et les combats des années 1960-1970 dans La symphonie du hasard (Belfond, 2018). Il présente un Paris pauvre et crépusculaire, où l’amour est rédempteur, dans La femme du Ve (Belfond, 2007) et traite de l’adultère assumé d’une Parisienne – « une idée irrecevable dans l’Amérique puritaine » – dans Isabelle, l’après-midi (Belfond, 2020).
Voilà peut-être pourquoi il est l’auteur américain préféré des Français : il aurait vendu 5 millions d’ouvrages dans notre pays. Cette double appartenance fait de Douglas Kennedy un observateur privilégié des États-Unis, à la veille de l’élection présidentielle de novembre. Descendant de réfugiés juifs allemands ayant fui le nazisme dans les années 1940, il a comme eux cru au « rêve américain ». Il en a bénéficié. Ses parents ont réussi. Lui-même a adoré vivre dans le New York des seventies. Et puis, depuis les années 2000, son pays rayonnant et libre, où chacun pouvait refaire sa vie, s’est délité. Grand entretien.
Le rêve américain, ma famille venue d’Allemagne y a cru, mais il est aujourd’hui moribond. Je suis né le 1er janvier 1955, d’une mère juive d’un quartier petitbourgeois de Brooklyn – elle est très vieille, maintenant. Quant à mon père, disparu, il a grandi dans un block populaire irlandais à New York. Quand j’étais enfant, une fois par mois, nous prenions le métro depuis Manhattan pour retourner à Brooklyn, et on passait l’après-midi avec mes grands-tantes Amelia et Millie, et son mari Joe.
Tous trois ont grandi et vécu à Munich jusqu’à la « Nuit de cristal », le pogrom des nazis contre les Juifs en novembre 1938. Ce fut une fuite éperdue. Grâce à des appuis familiaux, ils ont trouvé des visas à la dernière minute, pris le premier bateau, et sont arrivés à New York.
En 1938, Amelia avait 63 ans, Millie 58 et Joe 60… Ma grand-tante Amelia est morte en 1961, je l’ai fréquentée jusqu’à mes 6 ans. J’ai donc connu des gens nés en Allemagne à l’époque de Bismarck, qui étaient dans la fleur de l’âge pendant la Première Guerre mondiale, qui ont vu les nazis prendre le pouvoir, et qui sont arrivés aux États-Unis à la soixantaine. Quelle histoire extraordinaire !
Leur installation en Amérique n’a pas été facile, ils avaient tout perdu, ils parlaient juste l’allemand. Mais c’était ça ou Dachau… Pour eux, comme pour mes parents, et pour moi qui ai grandi avec, le rêve américain signifiait cette possibilité de refaire complètement sa vie, dans un pays égalitaire, une démocratie, avec des droits, des libertés, pas un régime dictatorial. Ce rêve, c’était aussi rejoindre la classe moyenne américaine, espérer une ascension sociale, se dire « on aura sa maison, deux voitures, un bon salaire, une vie stable, on enverra ses enfants à l’université« .
Ce grand rêve est né après la Seconde Guerre mondiale, il a fait vibrer beaucoup de gens à travers le monde, mais aujourd’hui il est brisé.
J’ai grandi à New York entre la 19e Rue et la 2e Avenue, dans un immeuble des débuts du XXe siècle, très classe moyenne, dans un grand appartement. À l’époque, les années 1960, New York était une ville très mixte socialement, très vivante, très diverse, avec des petits commerçants partout, des petits livreurs indépendants, des salles de spectacle. Dans les années 1970, la vie était bon marché ; je n’avais pas beaucoup d’argent, mais on trouvait facilement du travail, on allait dans les nombreuses salles de cinéma, dans des petits restaurants, aux concerts de jazz. Franchement, à l’époque, New York était une ville extraordinaire à vivre.
Aujourd’hui, tout a changé. La plupart des petits commerces ont fermé, on ne voit plus que des magasins de luxe et des chaines partout, des restaurants et des hôtels dispendieux. C’est devenu mission impossible de vivre dans une grande ville américaine quand on est de la classe moyenne. Tout est trop cher. Le logement, les médicaments, les sorties… Je suis bien obligé de le constater : l’hypercapitalisme l’a emporté.
Plus grave encore, la santé et l’éducation sont désormais hors de prix. Il est devenu très difficile d’éduquer ses enfants sans contracter d’énormes dettes. Et se soigner correctement exige d’avoir une assurance privée très chère. Pour la majorité des Américains, excepté une riche minorité, c’est un sujet de préoccupation constant.
Tous les politiciens républicains parlent de la famille, de la défense des valeurs familiales, mais rien n’est fait pour les protéger. La classe moyenne américaine est foutue depuis la fin des années 1990. Les ouvriers aussi souffrent. Je suis Irlandais par mon père et Américain par ma mère. Mes deux enfants, qui vivent en Irlande, ont décidé d’aller à l’université aux États-Unis. J’ai pris en charge leurs frais éducatifs pour 60 000 dollars par enfant et par an. C’est dingue ! Un étudiant doit s’endetter s’il veut faire des études supérieures aux États-Unis. J’ai dû beaucoup travailler pour payer leurs études. Je ne voulais pas qu’ils commencent leur vie avec de lourdes dettes. Comment démarrer dans l’existence dans ces conditions ?
Le délitement de la classe moyenne américaine a commencé sous le gouvernement Reagan, dans les années 1980. Le grand débat d’alors était : quel est le rôle de l’État ? Faut-il un État social ? Ce sont les ultralibéraux, les néoconservateurs qui ont imposé ces discussions. Une fois au pouvoir, ils ont tranché. Ils ont tué l’investissement, le système de protection sociale, l’État protecteur. En Angleterre aussi, Margaret Thatcher a voulu en finir avec l’État-providence et privatiser les services publics. Mais ce fut moins extrême qu’aux États-Unis, parce que là-bas le système de santé publique est très populaire et fonctionne bien. En Amérique, l’aide sociale a été démantelée sous Reagan et ses successeurs républicains, les Bush, puis Donald Trump.
Barack Obama a voulu inverser la tendance en créant « l’Obamacare », un système de sécurité sociale pour les plus démunis, comme il en existe dans toutes les grandes démocraties. Vous connaissez la suite : Donald Trump, en pleine pandémie du coronavirus, a décidé de le supprimer définitivement [en demandant en juin à la Cour suprême d’abroger cette loi]. Cela, alors qu’en juillet les États-Unis dépassaient les 3 millions de cas depuis le début de l’épidémie, avec plus de 130 000 morts, et que des millions de gens bénéficient de l’Obamacare. C’est incroyable, mais c’est la réalité ! C’est hallucinant !
Face au coronavirus, Donald Trump et le parti républicain pratiquent le darwinisme social. C’est la politique de la sélection naturelle. Le virus élimine les plus faibles, c’est-à-dire les plus vieux, les plus pauvres, les gens des minorités afro-américaines et latinos, ceux qui font les boulots dangereux, qui n’ont pas les moyens de se payer une assurance privée et un suivi médical très chers. Pour Trump et le « Grand Old Party » [Parti républicain], il est regrettable d’arrêter l’économie pour contenir la maladie. Beaucoup de gens ont la religion de l’effort aux États-Unis, de l’argent durement gagné, ils ont une mentalité de gladiateur. Ils admirent ceux qui font fortune. Les États républicains le savent, alors ils ont rouvert les magasins le plus tôt possible pour relancer l’économie, remettre les gens au travail, ils n’ont pas donné de directive pour que les habitants portent des masques ; au contraire, ils ont encouragé la population à sortir, en espérant développer une immunité collective.
Face au coronavirus, Donald Trump et le parti républicain pratiquent le darwinisme social.
Sénat d’extrême droite
Si bien qu’aujourd’hui, début juillet, nous avons plus de 50 000 nouveaux cas par jour, les hôpitaux de Floride et du Texas sont submergés par les malades et l’épidémie est repartie dans quarante États [sur cinquante]. Devant l’ampleur du drame, les gouverneurs républicains ont dû faire marche arrière, appeler les gens à garder leurs distances et à porter des masques, alors que la veille encore, eux-mêmes n’en mettaient pas, appelaient à rouvrir écoles et bars et à reprendre à tout prix le travail.
En France, beaucoup de gens me demandent comment Donald Trump a pu être élu alors qu’il ne semble visiblement pas être à la hauteur de la charge. Il faut d’abord savoir que Trump a volé l’élection de 2016. Il a perdu le vote populaire de près de 3 millions de voix. Le Parti républicain a tout fait pour dissuader beaucoup d’électeurs de voter. Et puis, le système électoral l’a favorisé… De temps en temps, je regarde pérorer Mitch McConnell, sénateur du Kentucky qui est aussi le chef du Sénat. Il est d’hyper extrême droite, il a protégé Trump pendant toute la procédure d’impeachment [destinée à destituer le président américain, elle a abouti à son acquittement, en février]. Alors, je suis d’accord, il y a des poètes valables dans le Kentucky, de beaux paysages et du bon whisky, le bourbon. Mais en dehors de ça, il y a une majorité des 4,5 millions d’habitants de cet État qui ont élu le réac Mitch McConnell. Maintenant, prenez la Californie démocrate, 40 millions d’habitants, la quatrième économie du monde, ou encore l’État de New York, 19 millions d’habitants, où le gouverneur démocrate Andrew Cuomo a mené une politique efficace de confinement et de précaution : eh bien, ces états envoient chacun au Congrès deux sénateurs, autant que le Kentucky peu peuplé ou le Wyoming, avec ses 600 000 habitants. C’est absurde ! Résultat, le Sénat se retrouve tenu par des gens d’extrême droite, venus de petits états sans pouvoir économique, des hommes sans expérience, ultra-partisans. Est-ce qu’il existe une solution à ça ? Je ne sais pas.
Ensuite, n’oubliez pas que Donald Trump l’a emporté dans les états de la « Rust Belt », chez les « petits blancs » de plus en plus pauvres mais qui travaillent dur, admirent les gagnants, des gens qui sont souvent contre l’Obamacare. Ils ont massivement voté pour lui parce qu’il incarne la réussite, qu’il est milliardaire (et ne paie pas ses impôts). Pour moi, ils ont voté contre leur propre intérêt. C’est comme pour le port de masque. Ils disent que ça va contre leur liberté, sans se soucier des autres. Je me souviens le premier dimanche de confinement dans le Maine, le 22 mars. C’était encore l’hiver ici, avec la neige partout. J’étais dans une station-service et j’avais mis un masque. Et il y a un type qui est entré, un camionneur, avec des tatouages. Il a été immédiatement hostile envers moi. Il s’est approché tout près, sans masque, et j’ai dû lui dire : « Monsieur, à deux mètres s’il vous plait. » Il m’a répondu agressivement : « Oh vous, vous êtes un homme de gauche ! » J’étais sidéré. Je lui ai dit : « Si vous tombez malade du Covid, vous vous répèterez cette phrase dans votre cercueil. » Puis j’ai insisté en ajoutant que ce n’était pas une question d’être de gauche ou de droite, mais de responsabilité, de respect pour les autres et les personnes fragiles. Il m’a crié dessus : « Vous êtes le genre de types qui veulent nous forcer à porter des masques ; ils parlent de vous tout le temps sur Fox News… «
Guerre culturelle
Pourquoi Donald Trump l’emporte-t-il dans la « Rust Belt » [région industrielle du nord-est des États-Unis] et les campagnes, chez les rednecks ? Il continue de mener la guerre culturelle. C’est Richard Nixon qui l’avait lancée dans les années 1970 pour renforcer le camp conservateur et discréditer la lutte des droits civiques des Noirs, les valeurs progressistes concernant l’avortement, l’égalité des femmes, les homosexuels, déconsidérer l’opposition à la guerre du Vietnam, en finir avec l’aide sociale promue par les démocrates… toute cette époque dont je parle au début de La symphonie du hasard. Nixon n’était certes pas d’extrême droite comme Trump – il a tenté de mettre en place un système de santé publique, il a créé l’Agence américaine de protection de l’environnement –, mais il a inauguré cette guerre culturelle. Il a affirmé qu’il y avait d’un côté l’Amérique profonde, celle de la « majorité silencieuse », chrétienne, laborieuse, familiale, blanche, conservatrice, armée, et de l’autre les « élites » urbaines, les politiciens progressistes, les intellectuels, les laïques, les défenseurs des minorités et de « l’assistanat », qui soi-disant méprisent le peuple, le travail, l’autorité, la majorité, la religion.
Depuis, les républicains poursuivent inlassablement cette guerre culturelle. Ronald Reagan a tout fait pour l’enflammer, et [son successeur] George H. W. Bush aussi : il a compris qu’il fallait être contre l’avortement pour emporter le vote conservateur et chrétien radical. Ensuite, en réaction aux deux mandats de Bill Clinton, l’extrême droite a peu à peu pris le contrôle du Parti républicain au nom de la guerre contre le « politiquement correct ». On l’a bien vu quand Trump a été élu. Pour s’attirer les voix de l’extrême droite, il a choisi comme vice-président un fondamentaliste chrétien opposé à l’avortement, Mike Pence.
Aujourd’hui, Trump envenime la guerre culturelle, il fait tout pour diviser les Américains, on l’a vu pendant son discours du 4 juillet au Mont Rushmore, où il s’est attaqué au mouvement Black Lives Matter et à l’extrême gauche, alors que la police tue des Afro-Américains, que la pandémie repart de plus belle et que le pays a besoin d’être rassuré. Les États-Unis sont de plus en divisés sous Trump. Je le vois chez moi, dans le Maine, où l’usage du cannabis est légal, où il y a des dispensaires, deux universités, une vie intellectuelle, mais aussi les travailleurs du chantier naval de Bath, des bikers, une extrême droite virulente. Nous sommes très divisés. Il y a un gouffre entre les partisans de Trump et ses opposants. Il y a aussi un gouffre de l’éducation aux États-Unis, je le vois tous les jours. Peut-être 10 % à 15 % de gens lisent des livres, ici. Beaucoup ne voient pas que les inégalités sociales se sont creusées, que Trump s’occupe d’abord de réduire les impôts des riches, que nous vivons dans une sorte de ploutocratie.
Bon, en même temps, les États-Unis restent un pays génial à vivre. Prenez la culture, justement : nous sommes à l’avant-garde pour nos universités, nos chercheurs, nous sommes reconnus grâce à notre cinéma, le jazz, la musique populaire, l’innovation technologique… En fait, beaucoup de choses extraordinaires se font ici. Nous avons déjà connu une période sombre dans les années 1950, sous le sénateur républicain Joseph McCarthy, qui n’est pas sans rappeler Donald Trump. Je décris cet épisode dans mon roman La poursuite du bonheur et je tiens à dire que si nous avons subi McCarthy, nous nous en sommes débarrassés. Ensuite, nous avons connu l’effervescence culturelle, politique, sociale des années 1960-1970, le mouvement des droits civiques. Et après Georges W. Bush, nous avons élu Barack Obama, un président noir. Aujourd’hui, regardez ce qu’il se passe… Nous voyons ces énormes manifestations de femmes, de jeunes contre le réchauffement climatique, le mouvement Black Lives Matter, et tous ces scientifiques, ces villes, ces entreprises qui se mobilisent contre Trump, qui résistent aux mensonges officiels.
Aujourd’hui le pays est si troublé que nous oublions l’essentiel. Les démocrates peuvent gagner l’élection. Chez moi, dans le Maine, en septembre 2018, pendant les midterms [élections de mi-mandat], les électeurs ont choisi à 53,3 % la démocrate Janet Mills comme gouverneure de l’État. C’est la première fois qu’une femme l’emporte ici. Elle a déjà beaucoup fait. Elle a renforcé Medicaid, le système de santé, facilité la construction de logements pour personnes âgées, créé un incubateur de start-up et même libéralisé la marijuana… Elle va dans la bonne direction.
Il nous faut investir dans les États-Unis, dans la population – je veux dire dans l’éducation, dans les HLM pour les pauvres, dans la santé publique, dans les projets culturels, qui sont fondamentaux. Il nous faut œuvrer à un capitalisme plus social, plus modéré, plus régulé, investir dans les services publics, contrôler les excès des financiers et de l’esprit d’avidité. Donner un nouveau sens au rêve américain.